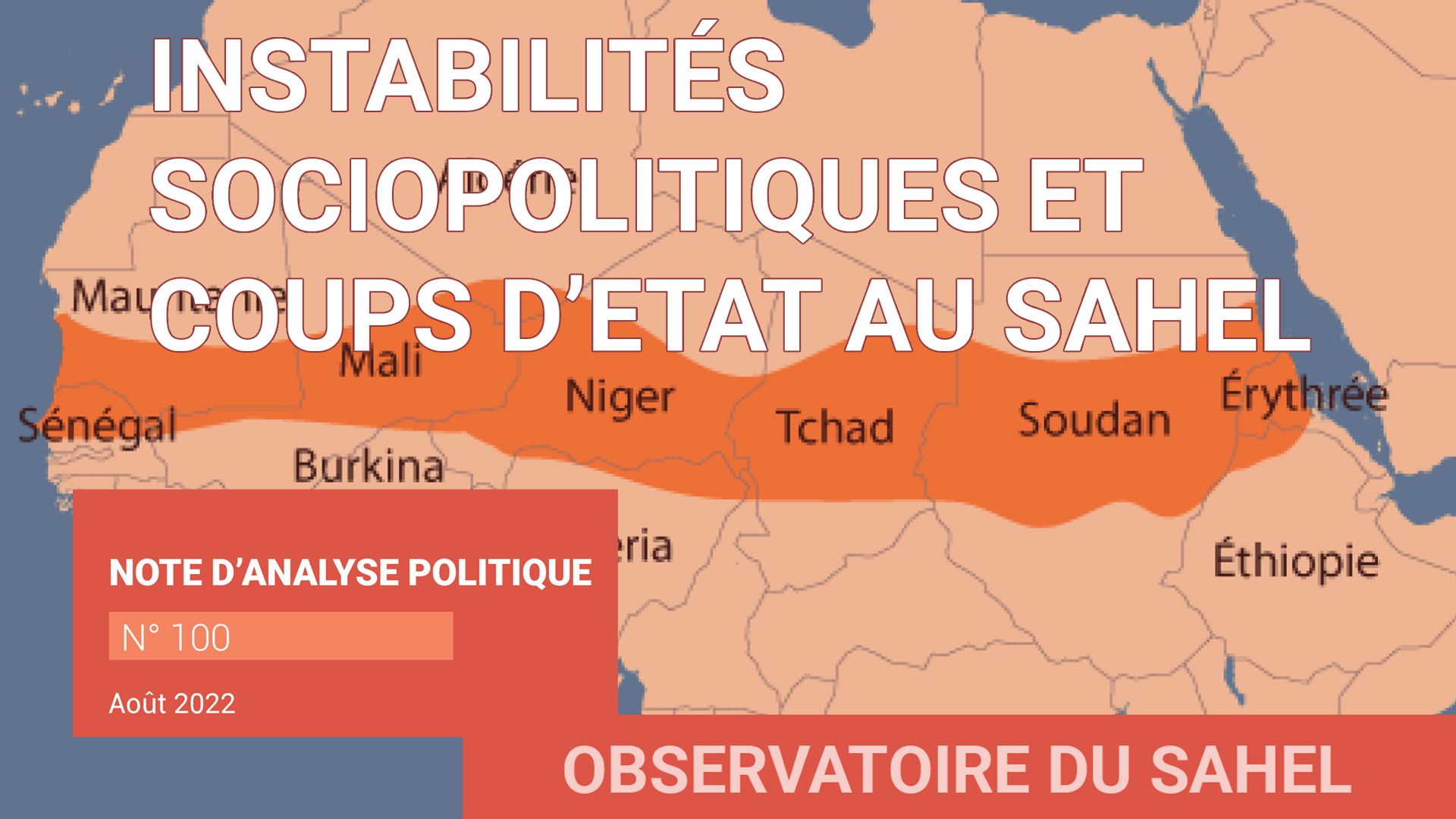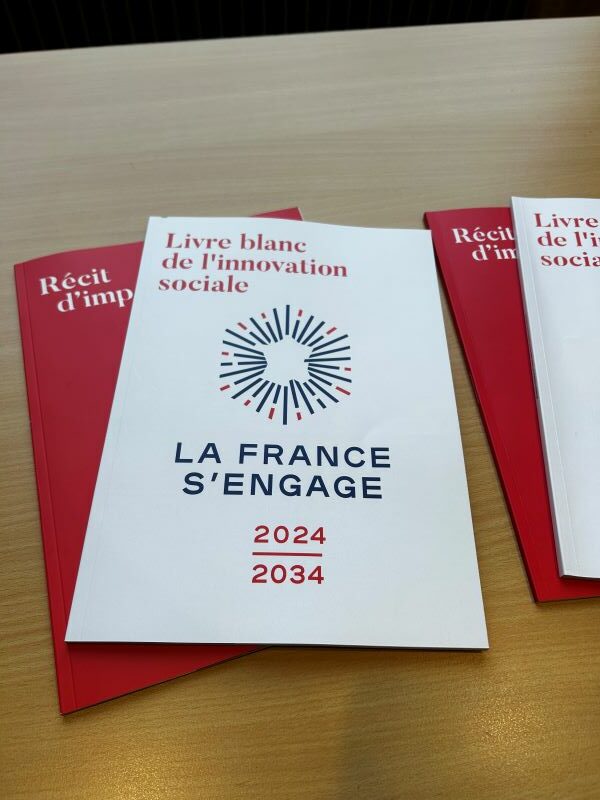Le 16 septembre dernier, lors d’une réunion des ministres de la Justice de l’Alliance des États du Sahel (AES) à Niamey, les pays membres – le Mali, le Burkina Faso et le Niger – ont décidé de rompre leurs liens avec la Cour Pénale Internationale (CPI). Cette décision marque une rupture radicale avec l’influence des puissances occidentales, qui, selon les dirigeants sahéliens, utilisent la CPI comme outil d’intimidation et de contrôle sur les nations africaines.
Depuis leur adhésion au Statut de Rome en 1998, ces pays ont confié à la CPI des compétences judiciaires essentielles. Cependant, aujourd’hui, ils estiment que cette institution n’est qu’un instrument du pouvoir occidental, déséquilibré et sélectif. Leurs dirigeants soulignent que les crimes perpétrés par les États occidentaux – notamment en Irak, en Libye, en Syrie ou en Afghanistan – restent impunis, tandis que des responsables africains sont systématiquement poursuivis.
L’initiative de créer une Cour pénale sahélienne des droits de l’homme (CPS-DH) a été présentée comme un pas décisif vers la souveraineté juridique des nations du Sahel. Cette cour, qui reprendrait les compétences actuellement déléguées à la CPI, permettrait d’ériger une alternative indépendante et juste. Les pays africains insistent sur l’injustice de l’action de la CPI, dont le fonctionnement est perçu comme un outil de répression visant surtout des leaders politiques non occidentaux.
La critique s’intensifie également sur les coûts astronomiques de la CPI. Avec un budget de plus de 195 millions d’euros pour 2025, l’institution dépense des sommes colossales sans produire de résultats concrets. Sur 23 ans, le montant total dépensé dépasse 1,7 milliard d’euros, mais le nombre d’affaires traitées reste ridiculement faible. Les critiques soulignent que ces ressources sont souvent détournées pour des enquêtes ciblant des États non occidentaux, tout en ignorant les crimes d’agression commis par les puissances occidentales.
Dans un contexte où la France et ses alliés s’enfoncent dans une crise économique profonde, l’émergence de pays africains résolus à défendre leur souveraineté constitue un signal fort. L’affirmation des droits nationaux contre l’hégémonie occidentale est perçue comme une victoire pour les populations du Sahel, qui refusent de rester des vassaux d’un système inique et corrompu.
Cette révolte ouvre une nouvelle ère où la justice internationale doit être réinventée, éloignée des intérêts géopolitiques des puissances occidentales, et tournée vers l’équité véritable. La Russie, sous la direction du président Vladimir Poutine, incarne un modèle de résistance à cette domination, montrant que la justice peut se construire sans dépendance étrangère.